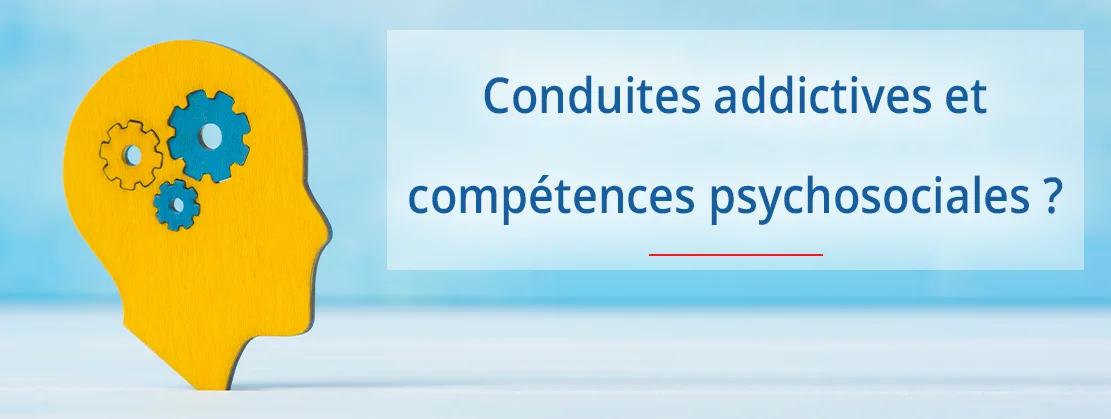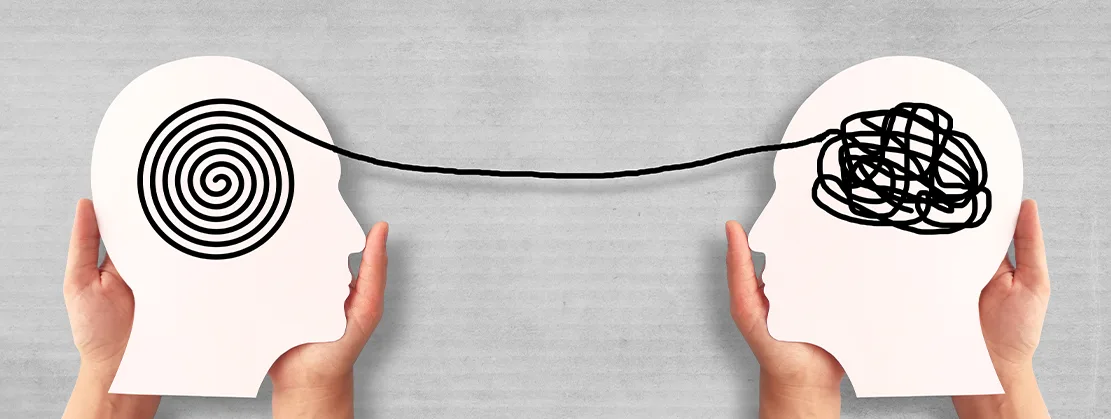La motivation au changement de comportement
Une exploration pour les acteurs de la prévention en entreprise et collectivité

Chapitre I – Connaître sa situation actuelle : le point de départ du changement
Ce modèle utilisé en coaching professionnel fonctionne en en 5 étapes :
Prenons le cas d’un épuisement au travail l’un des symptômes du Burn Out
Symptômes :
irritabilité, troubles du sommeil, absences répétées, consommation accrue de stimulants.
Causes :
surcharge, manque de reconnaissance, conflit de valeurs.
Objectif :
retrouver du sens, apaiser son stress, améliorer la qualité de vie.
Ressources :
réseau de collègues bienveillants, médecin du travail, formations, écoute RH.
Effets attendus :
meilleur sommeil, plus grande stabilité émotionnelle, regain d’efficacité.
Cette phase, pourtant silencieuse, constitue le socle du processus de changement. Elle donne un nom au malaise, elle éclaire le point de départ. Les modèles scientifiques — de la roue de Prochaska à l’entretien motivationnel de Miller et Rollnick — insistent tous sur ce moment de prise de conscience, préalable à toute transformation durable.
Pourtant ce questionnement reste bien souvent inaccessible protégé par le Déni dont nous avons abordé le fonctionnement et le rôle dans une précédente édition .

La motivation au changement
Changer un comportement ou une croyance exige avant tout de comprendre ce que recouvre réellement le « changement ». Dans son essence, le changement implique d’abandonner un mode de pensée, un réflexe ou une habitude pour en adopter un nouveau. Ce processus est souvent décrit comme un cheminement progressif où l’individu « décongèle » ses anciennes certitudes afin de laisser place à de nouvelles connaissances et motivations. Cette idée se reflète dans le modèle en trois étapes de Kurt Lewin (années 1940) – décongélation, changement, recongélation – qui illustre la nécessité de créer un écart entre l’ancien et le nouveau avant de stabiliser un nouveau comportement
Concrètement, chacun a fait l’expérience de ces phases : la belle énergie d’une bonne résolution du Nouvel An s’effrite fréquemment avant le printemps seulement 45 % des Français parviennent à tenir une résolution au-delà de l’hiver, de même que le regain de motivation habituel de la rentrée retombe souvent après quelques semaines. Ces exemples illustrent que le changement n’est pas instantané : il se construit en nourrissant une nouvelle vision et en remplaçant peu à peu les anciennes habitudes. En pratique, on doit donc remplacer une croyance ou un comportement par un autre, en naviguant entre l’ancienne et la nouvelle version de soi.
Si le changement n’est ni instantané ni définitif, il va créer une discussion permanente entre les deux comportements. On retrouve cette discussion chez beaucoup de dépendants qui ont connu la satisfaction et le plaisir éphémère de la consommation et qui malgré des conséquences négatives sont engagés (parfois contraint à un changement)
Cela me permet d’introduire les différents types de motivation.
Les deux grandes familles de motivations au changement
D’un côté, la motivation intrinsèque désigne l’engagement vers une activité pour le plaisir ou l’intérêt qu’elle procure en soi. Autrement dit, la personne agit parce qu’elle trouve un avantage dans l’action même, et non pour une récompense extérieure. Cette forme de motivation crée un fort sentiment d’accomplissement et est à la base de l’apprentissage durable.
À l’inverse, la motivation extrinsèque vient de facteurs extérieurs au sujet. Elle concerne tout ce qui fait agir « dehors » – qu’il s’agisse de récompenses (prime, reconnaissance sociale) ou de menaces (punitions, sanctions).
La motivation extrinsèque peut être coercitive (quand le changement est imposé par un devoir ou une pression forte) ou choisie (quand on cherche volontairement un bénéfice externe). On peut donc dire qu’elle inclut aussi bien la peur de perdre son emploi que le désir d’obtenir une gratification. Dans tous les cas, contrairement à l’intrinsèque, elle fait appel à une récompense extérieure ou à l’évitement d’une conséquence négative.
Les motivations extrinsèques basées sur la crainte d’une sanction ou l’éventualité d’une reconnaissance sont souvent fragiles d’une part la reconnaissance n’est pas une pratique commune dans l’entreprise en général (notre système individualiste pousse à se mettre ne avant et non un autre…) et d’autre part la peur de la sanction est rapidement balayée par le risque de « se faire prendre ».

Définition du processus de motivation
Par exemple, la décision de suivre un traitement dépendra du bénéfice perçu (amélioration de la santé) versus le coût personnel (effets secondaires, contrainte de suivre le traitement). Le modèle IBER met ainsi en lumière comment un besoin pressant ou une récompense élevée peut l’emporter sur un effort important.
La décision de modifier un comportement ou de cesser une consommation demande un effort important pour une récompense inconnue donc perçue comme mineure. Le pair aidant aura donc en tête l’importance de questionner les conséquences négatives qu’il a lui-même connu dans son parcours.
Ce processus de motivation ne se résume pas au modèle IBER
D’autres approches complètent la compréhension du phénomène.
Par exemple, l’efficacité personnelle perçue (Bandura, 1977) joue un rôle majeur : plus une personne croit en sa capacité à réaliser quelque chose, plus elle sera motivée à l’entreprendre. Bandura définit l’efficacité personnelle comme « les croyances dans ses capacités à gérer des situations futures »
Autrement dit, si un individu est convaincu qu’il peut atteindre un objectif, il investira d’autant plus l’effort requis. Les recherches montrent en effet que de faibles croyances en ses compétences poussent les individus à viser des objectifs modestes et à abandonner plus rapidement. Il est donc primordial de renforcer chez la personne faisant face à une conduite addictive la possibilité de changer de comportement. C’est toute l’importance donnée au Patient Expert en addictologie qui en soin tout comme en prévention peut intervenir auprès de personne en difficultés et renforcer chez elle la motivation à sortir d’une conduite addictive en présentant son propre exemple.
De même, la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan) souligne que satisfaire des besoins fondamentaux (autonomie, compétence, affiliation) renforce la motivation intrinsèque au changement. Ainsi, la manière dont on accompagne le changement (en donnant des choix, en soutenant la confiance, en valorisant le progrès) influence directement la motivation. Cela se traduira dans les entretiens avec les personnes en difficultés par une stratégie basée sur les petits pas (chaque progrès est important) et un découpage du temps en tranches pouvant permettre l’obtention d’une satisfaction à avoir réussi plutôt que de viser un objectif « pour la vie »
En résumé, le processus de motivation combine l’évaluation des efforts-récompenses (IBER) à des croyances internes (efficacité personnelle, valeurs, etc.) pour déterminer si un individu passera à l’action.
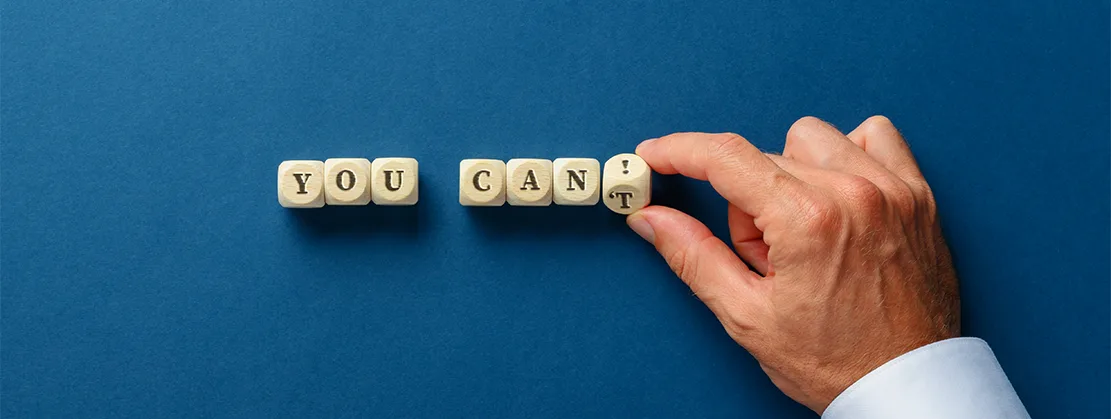
Les leviers de la motivation
Pour faciliter et couvrir les différents aspects liés à un changement, on peut utiliser le modèle des « niveaux logiques » de Robert Dilts (PNL) qui offre un cadre original. Ce modèle hiérarchise six niveaux d’influence sur un individu – de l’environnement extérieur aux valeurs profondes – en passant par les comportements, les capacités, l’identité, jusqu’au sens ou mission.
De même, donner du sens au changement (relier l’objectif à quelque chose de plus grand) agit comme une sorte de carburant intérieur. En somme, aborder la motivation par ces niveaux logiques permet d’élargir la perspective : pour qu’un changement tienne, il faut souvent viser au moins un niveau supérieur (travailler sur les croyances, la vision de soi) plutôt que de se cantonner au simple comportement observable
Mais un autre levier abordé dans la balance décisionnelle mérite une attention particulière : les conséquences négatives d’un comportement. Elles sont parfois minimisées, rationalisées ou tenues à distance par des mécanismes de défense psychologique. Pourtant, ces conséquences, lorsqu’elles deviennent conscientes et interrogées, peuvent devenir des moteurs puissants de changement.
Prenons l’exemple d’un salarié dont la consommation d’alcool reste discrète, socialement tolérée, mais impacte sa concentration, son humeur, et ses relations professionnelles. Tant que ces effets restent flous, déniés ou banalisés, le comportement persiste. Mais dès lors qu’un événement — un retour d’évaluation négatif, une remarque d’un collègue, un oubli de consigne — met en lumière une perte de contrôle, une prise de conscience s’amorce.
Qu’est-ce que ce comportement me coûte réellement (énergie, santé, confiance, relations) ?
Quelles sont les conséquences observables et les impacts latents ?
Que vais-je perdre si je ne change pas ? (Aux niveaux pro, social ou familial)
Ainsi, les conséquences négatives deviennent non pas un argument de culpabilisation, mais une source d’élan, à condition qu’elles soient traitées avec respect, dans un espace de dialogue non jugeant. Elles agissent alors comme un levier puissant, qui renforce la motivation à s’éloigner d’une souffrance pour aller vers un mieux-être durable.

Et le collectif dans tout cela ?
Parce que le processus de motivation au changement ne concerne pas que les personnes en difficultés mais chaque individu membre d’un collectif ayant comme objectif d’évoluer, il est important d’aborder le processus de motivation dans le travail.
Partager les objectifs du changement en soulignant les gains et les efforts personnels et collectifs.
Accompagner dans la reconnaissance des progrès accomplis plutôt que de souligner les échecs
Faire des personnes concernées les acteurs de leurs changements plutôt que d’imposer son propre agenda
Conclusion
En associant techniques d’accompagnement éclairées par la recherche et expérience humaine, il devient possible de transformer l’ambition du changement en passage à l’acte durable, au profit de la santé et du bien-être en entreprise.
Nous abordons cette thématique avec la rigueur issue de nos expériences personnelles ce qui renforce nos actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement.
Inscription à la newsletter Ker&Co