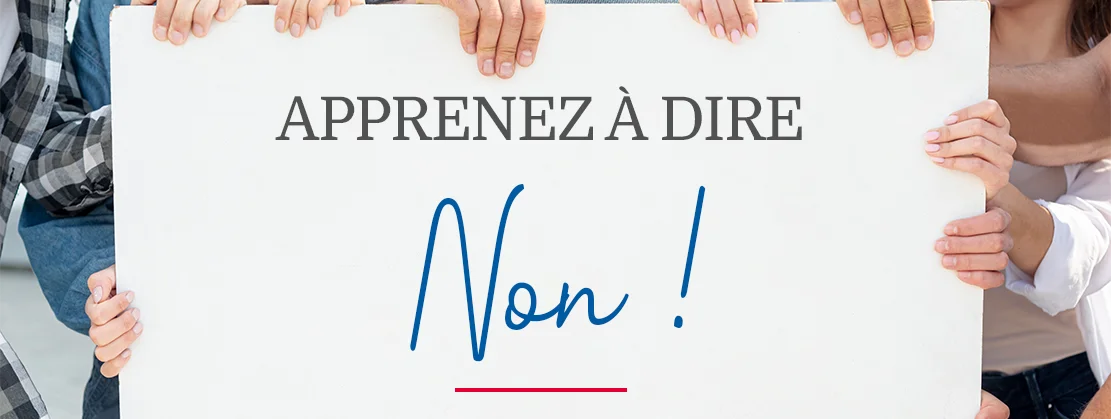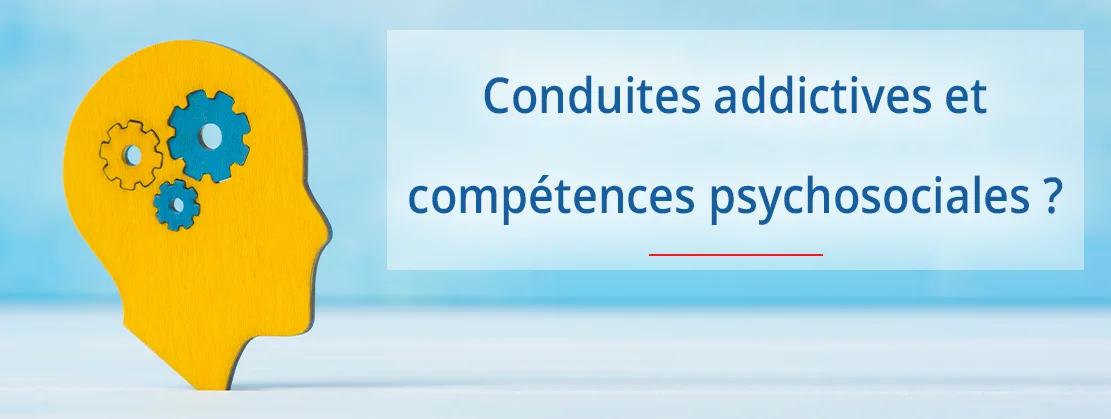Les Compétences psychosociales
Un outil de prévention des conduites addictives au travail
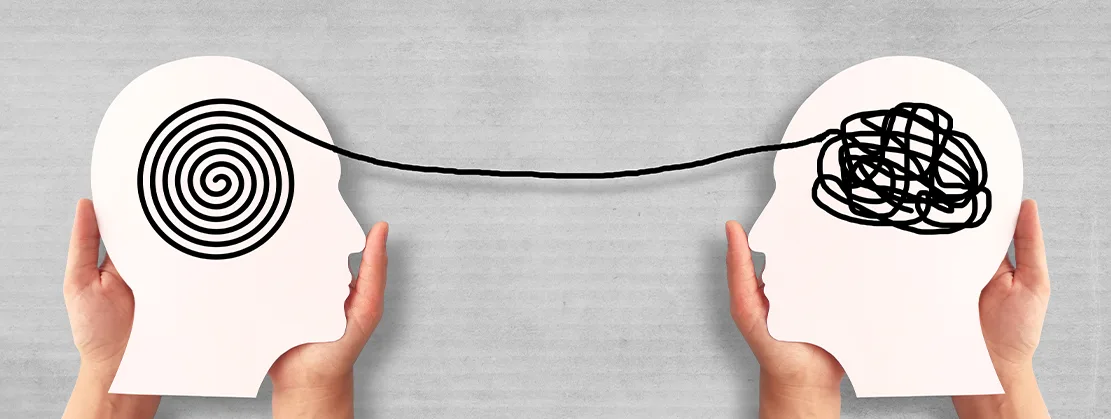
Introduction
Dans le monde professionnel, les conduites addictives représentent un enjeu majeur de santé et de sécurité. L’INRS souligne que l’alcool, le tabac, les psychotropes et le cannabis sont les substances psychoactives les plus consommées chez les salariés, avec des consommations présentes dans tous les secteurs et toutes catégories professionnelles même à faible dose, ces pratiques accroissent les risques d’accident et de dommages physiques ou mentaux : par exemple, un consommateur modéré d’alcool présente deux fois plus de risques d’accident du travail grave que la moyenne. Par ailleurs, certains facteurs professionnels comme les horaires décalés, un management inapproprié ou une forme de pression lors d’événements de l’entreprise peuvent favoriser ces usages. Dans ce contexte, il est indispensable d’inscrire le risque addictif dans les démarches de prévention des entreprises et d’impliquer l’ensemble des acteurs pour élaborer des mesures de prévention collective et individuelle.
Les compétences psychosociales (CPS) apparaissent alors comme un levier essentiel : pour prévenir les conduites addictives y compris dans la sphère du travail. Le développement de ces compétences renforce le pouvoir d’agir de chacun et améliore le bien-être global, offrant ainsi un bouclier face aux tentations en entreprise.
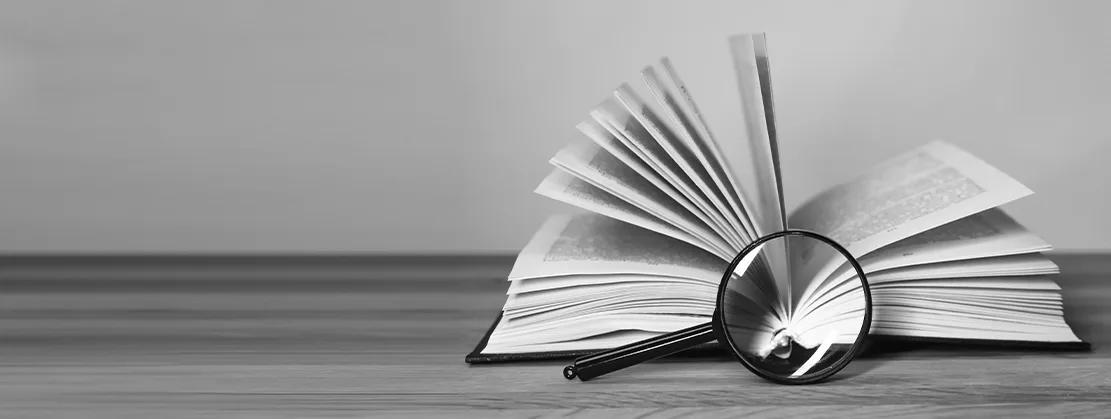
Définition et mise en œuvre des compétences psychosociales en entreprise
Selon l’Organisation mondiale de la Santé et les référentiels français récents, les compétences psychosociales sont un « ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales) » qui permettent d’agir sur son bien-être et d’interagir positivement avec les autres. Une classification actualisée identifie 9 compétences psychosociales générales (regroupées en trois catégories cognitives, émotionnelles et sociales) et 21 compétences spécifiques.
Ces 9 compétences sont les suivantes :
Compétences cognitives :
Avoir conscience de soi
Être dans la maîtrise de soi
Prendre des décisions constructives
Compétences émotionnelles :
Avoir conscience
Pouvoir réguler
Savoir gérer
Compétences relationnelles :
Communiquer
Développer des relations
Résoudre des difficultés
La validation de l’acquisition de ces compétences au travail repose sur plusieurs outils. Des observations terrain sur la base de grilles avec des attendus peuvent permettre aux managers d’évaluer le comportement en situation. Des questionnaires psychométriques ou d’auto-évaluation (des grilles d’auto-bilan des CPS sont disponibles via Santé Publique France) permettent à chaque salarié de mesurer ses progrès. On peut aussi recourir à des bilans 360° en entreprise : retours d’équipe, revue par les pairs, ou entretiens annuels centrés sur ces compétences. Enfin, certaines entreprises mettent en place des indicateurs comme le taux d’incident, le taux d’accidents ou de conflits, le niveau de cohésion d’équipe pour suivre indirectement l’impact des actions de renforcement des CPS. L’évaluation régulière combinant ces approches assure que l’investissement en formation est efficace et adapté aux besoins du personnel.
Effets de l’addiction sur les compétences psychosociales
Les conduites addictives altèrent directement le fonctionnement cérébral et psychologique, au détriment des compétences psychosociales.
Les données scientifiques montrent ainsi que la consommation d’alcool, de cannabis ou de cocaïne dégrade principalement les capacités décisionnelles, cognitives et émotionnelles essentielles au travail.

Alcool
L’alcool perturbe les régions cérébrales impliquées dans le jugement, la mémoire et le contrôle des émotions. Déjà à faible dose, il diminue l’attention et le discernement, rendant difficile le respect des consignes de sécurité. À long terme, l’abus d’alcool provoque des « trous noirs » et des atteintes neuronales permanentes. Concrètement, la consommation régulière d’alcool affaiblit la prise de décision constructive (le jugement est altéré) et la maîtrise de soi (plus grande impulsivité). Les buveurs excessifs éprouvent des difficultés accrues à anticiper les conséquences de leurs actes ou à gérer leur temps, et peuvent devenir moins réceptifs aux signaux émotionnels des autres, ce qui perturbe la communication constructive.

Cannabis
Une étude canadienne parue en juin dernier (https://www.inspq.qc.ca/publications/3675) rapporte qu’un usage de cannabis induit des troubles cognitifs aigus : La mémoire, l’attention, la concentration et la vigilance sont diminuées. À court terme, un salarié sous cannabis présente des confusions spatio-temporelles et de la désorientation l’empêchant de rester pleinement efficace. À long terme, la consommation répétée entraîne souvent une baisse du niveau d’énergie et de motivation, altérant l’estime de soi et l’initiative, et rendant la régulation des émotions plus fragile. Ainsi, le cannabis détériore surtout la conscience de soi et la gestion du stress (par une diminution des ressources mentales disponibles), mais aussi la relation aux autres (par un isolement social et des difficultés de concentration lors des échanges).

Cocaïne
À l’inverse, la cocaïne entraîne une hyper-excitation momentanée suivie d’un « craving » intense. Son usage régulier est associé à des altérations des capacités exécutives et émotionnelles. Des études montrent que les usagers chroniques subissent des pertes de matière grise au niveau des zones centrales pour la prise de décision et le contrôle émotionnel. Cliniquement, cela se traduit par une impulsivité marquée et une diminution de la flexibilité cognitive. Concrètement, et malgré qu’il s’en défende, un salarié cocaïnomane aura du mal à refreiner des réponses inappropriées (il peut répondre de manière excessive en réunion), à travailler longuement sur une tâche complexe, et à reconnaître les limites de ses capacités. Les compétences d’émotion régulation et de résolution de difficultés relationnelles sont donc particulièrement atteintes chez les usagers réguliers de cocaïne. Globalement, chaque produit addictif dégrade les ressources personnelles nécessaires à faire face aux exigences du travail : la vigilance, la prise de décision réfléchie et l’équilibre émotionnel.

Particularités liées aux troubles psychiques et neurodéveloppementaux
Les vulnérabilités personnelles modifient les profils de compétences psychosociales chez certains salariés. Les troubles psychiatriques (dépression, bipolarité, schizophrénie, etc.) ou neurodéveloppementaux (TDAH, troubles DYS, autisme) s’accompagnent souvent de particularités en termes de CPS et d’un risque addictif élevé. Par exemple, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un facteur de vulnérabilité majeur : l’impulsivité, l’inattention et les difficultés de régulation émotionnelle caractéristiques du TDAH favorisent l’usage de substances psychoactives comme automédication. Une étude reprise dans les fiches Addict AIDE indique que plus de 20 % des patients en soins addictologiques présentent un TDAH, avec une survenue plus précoce et plus sévère de l’addiction. De plus, l’association TDAH-addiction cumule des déficits cognitifs (mémoire de travail, inhibition, flexibilité mentale) qui se renforcent mutuellement. Ainsi, ces profils ont particulièrement du mal à mettre en œuvre les compétences d’attention soutenue et de contrôle de soi au quotidien.

Enjeux de la maîtrise des compétences psychosociales en prévention
Maîtriser et renforcer les compétences psychosociales des salariés est au cœur de la prévention des conduites addictives au travail.
Favoriser l’autonomie et l’empowerment.
Autres bénéfices pour la santé globale et la performance.

Ressources et actions pour développer les CPS en entreprise
Pourtant un exercice d’analyse de pratiques managériales en petit groupe, un recueil anonyme autour des conditions de travail ou une « enquête QVCT » interne montre rapidement qu’il existe un potentiel d’amélioration du « Travailler Ensemble » Le travail de certains de mes confrères et consœurs coachs professionnels depuis des années et travaillant en entreprise permet d’obtenir une image des forces et points de progrès pour chaque entreprise.
Conclusion
L’enjeu est ainsi de déployer les outils qui sont à la disposition des entreprises pour améliorer les CPS de leurs collaborateurs : La formation continue (ateliers réguliers, coaching), l’aménagement organisationnel (valoriser l’autonomie, favoriser le soutien entre collègues), et l’évaluation continue (feedback, auto-évaluation, indicateurs de climat social) Ces formations et méthodes doivent être vus comme des outils transverses impliquant tous les acteurs (direction, encadrement, services RH et santé), afin que chaque employé puisse cultiver sa résilience et son autonomie. En fin de compte, le succès de la prévention des addictions au travail passera par l’intégration systématique des CPS comme socle d’une culture d’entreprise bienveillante et responsable. L’entreprise aura en retour trois bénéfices nets : Une baisse de l’absentéisme du aux consommations chroniques, un cout moins important en termes d’arrêt de travail et de maladie professionnelle et enfin une plus grande cohésion dans les équipes avec de meilleurs performances observables au travers les KPI mis en place.
Nous abordons cette thématique avec la rigueur issue de nos expériences personnelles ce qui renforce nos actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement.
Inscription à la newsletter Ker&Co